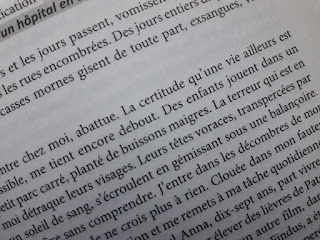Incisif et réflexif, Chienne, de Marie-Pier Lafontaine, sorti au Québec chez
Héliotrope il y a un an et tout juste publié en France par Le Nouvel Attila le
4 septembre 2020, est un premier roman qui ne mâche pas ses mots. Une
autofiction percutante qui, pour décri-re/-er la réalité d’un « viol suspendu, inceste
latent », traque
l’ombre derrière la proie sans en lâcher aucune.
Crédits photo à la fin de l'article
« Parmi toutes les lois du
père,
il y en avait une
d’ordre capital :
ne
pas raconter »
Chienne est le livre d’une
survivante, le résultat d’un travail d’excavation sans concession dans la forme
comme dans le fond qui en entraîne ici, plus humblement, un autre. D’où ces
quelques mots en guise de précaution pour rappeler quelques évidences :
tout ce que vous trouverez ici est, mais n’est pas dans le livre. Chienne
est un livre court et clair, saisissant et abordable, qui, pour partir d’une
réalité, parle de lui-même. Aussi, quitte à l’évoquer, autant envisager, en plus
de ce qu’il est, ce qu’il peut faire. Une démarche que je rappelle
régulièrement et que nous avions, à la demande de L’Ogre, explicitée avec Lou
lors de nos Manifestes
de la critique.
La littérature me fait, le monde
me fait – la violence, la révolte, l’enthousiasme, l’amour, l’expérience me font
– l’écriture me fait, la lecture me fait. A leur contact, je me fais moi-même
chaque jour davantage. J’ai envie de parler de ce qu’un livre me fait, et en
quoi, mais aussi de ce qu’il dit/fait de sa/ma/notre réalité. De ce que je peux
faire de ce livre, mais également de ce que je peux faire de ce qu’il me fait.
De son action sur le réel, sur moi qui suis dans cette réalité, de notre
rétroaction sur elle. Et ce d’autant plus quand la fiction vise, non seulement
à rendre compte de, mais à dépasser pour mieux surpasser la réalité que l’on
nous fait, qui nous fait et que l’on peut faire/refaire/défaire à notre tour.
Qu’est-ce que cela peut me
faire ? Souvent
l’expression est utilisée avec dédain. Comme si, en l’occurrence ici, ce que l’autrice
fait de ce que le père fait de la narratrice ne nous touchait pas, ne nous
regardait pas. Comme s’il s’agissait de phénomènes isolés, apparaissant par intermittence,
échappant à notre entendement et donc à notre action. Mais nous vivons parmi
les monstres, et les monstres sont parmi nous, quand ils ne sont pas en nous.
En puissance ou non, qu’ils s’ignorent ou non. Même et surtout quand ils
s’ingénient à faire le mal et le malin, comme ici, il n’y a pas de génie du mal,
aucune intelligence là-dedans, rien à comprendre et moins encore à excuser. Raison
de plus pour se sauver, et sauver celles et ceux que l’on peut.
Le diable fait rarement dans le
détail : il est bête et méchant, tourne en rond, projette son mal être sur
les êtres qui l’entourent. Il est grossier, exhibe sa queue et ses cornes, aiguillonne
les damnés vers et dans les flammes de l’enfer. S’il n’avait pas cette aura,
s’il y avait une échappatoire, si l’on avait la force ou l’aide nécessaire,
si l’on ne nous avait pas convaincu·e·s de son autorité et de notre culpabilité
depuis l’enfance, l’on aurait juste envie de se retourner et de lui en coller
une. C’est ce que fait Marie-Pier Lafontaine qui, avec mordant, lui réserve un
chien de sa Chienne. Voilà ce que j’aimerais mettre en lumière, en écho,
en disant pour une fois davantage qu’en faisant sentir, sinon l’urgence et la
nécessité, l’importance d’un tel livre.
En souhaitant qu’à sa suite les
langues se délient, que l’échine se dresse, que les griffes et les crocs s’acèrent,
et que la colère se déchaîne.
« Il brandit un collier. Tape sur sa cuisse. Ici, ici. Le père, il me dit souvent. Trop souvent. Tant qu’à être une sale chienne, aussi bien l’être jusqu’au bout (...) M’obliger à jouer à la chienne est le meilleur moyen qu’il a trouvé pour que je traîne nue à ses pieds. »
« Il vaut mieux exister en tant
que chienne que de ne pas exister du tout. »
Elle était, toutes ces fois, une
petite fille traitée comme – jamais on n’oserait traiter – une chienne, qui
survécut et devint une jeune femme. Qui replongeant dans son passé raconte
comment, tenue en laisse, elle est soumise avec la complicité de la mère aux
pires sévices par un père incestueux, tortionnaire, pervers et misogyne. Un
père obscène, obsédé, irascible, insatiable, excité et nourri par la terreur et
la souffrance qu’il sème. Qui se répand sans répit autour de lui, en injures, en
menaces et coups, en semonce et semence. Qui jette sans cesse son dévolu sur
ses filles. Avec pour seul interdit, posé par la mère, de les pénétrer
sexuellement.
Les humiliations, les pleurs, les
coups, les plaies, les hurlements : à partir de là, tout devient prétexte
à, moyen de, repousser les limites du supportable et du tabou, faisant du
quotidien le vaste terrain de jeu d’un exercice à contrainte. Le personnage du
père, s’il est particulièrement monstrueux, et à ce titre emblématique, n’est
pas pour autant celui d’un conte, d’un fait divers. S’il paraît isolé c’est
parce qu’il isole, cloisonne ses proches et nous avec, par la sidération que
provoque le trop-plein de ses exactions. Mais, pour peu que la parole se
libère, l’on réalise combien il apparaît plus proche car plus commun qu’on ne
pourrait le penser en réalité.
« Nous étions, ma sœur et
moi, les victimes parfaites pour le père. Nous avions toutes deux un vagin. »
Cette histoire relate la douleur
et l’horreur de la condition qui est faite aux enfants et aux femmes, interroge
le pouvoir de l’écrit qui pointe la banalité du mal au sein même de la cellule familiale. Le monstre qui ne
devient monstre – Papa-monstre – qu’à partir du moment où on le montre,
le dénonce, le nomme. Le mâle prédateur qui, sorti de la norme, épinglé tel
qu’il hait, est encore présenté sous les traits bonhommes du bon père de famille
par les médias, voisins et pairs feignant l’ignorance et la stupeur. Dont les tares
(d)énoncées, réunies, révèlent un mal prétendument insoupçonnable. Quand
chacune, pourtant, suffirait à le rendre monstrueux et donc punissable.
Ce constat, loin de relativiser les
crimes du père, montre au contraire combien ils sont permis, tolérés, tus. Seuls
l’autorité que la société lui confère et le silence qu’il impose à l'intérieur comme au dehors du foyer lui permettent de poursuivre sa vie criminelle sans être
poursuivi. De s’assurer en toute impunité de son pouvoir en abusant de celles
et ceux qui y sont soumis. C’est pourquoi il est important, de soustraire les
mots et les corps à cette emprise, de les exfiltrer, de les faire exister (du
latin exsistere : sortir, naître, se montrer ) hors de lui,
poussés par et malgré la haine et la honte que le foyer concentre, entretient, irradie.

La plupart d’entre nous, les
femmes et les enfants d’abord, ont déjà été victimes ou témoins dans leur vie de
violences commises avec la complicité ou non, le silence ou non, de son
entourage. Dans le meilleur des cas, on sait que ce n’est pas normal. Dans la majorité,
on tente de se rassurer. On se dit que cela ne peut pas durer, qu’une personne
va intervenir. Dans la réalité, on ne peut se fier ni à la bonne volonté du
bourreau ni à celle des autres. Qu’aucun enfant, qu’aucune femme, qu’aucune
personne ne puisse plus être : battue, humiliée, violée, maltraitée ou
menacée de l’être, victime de l’autorité de qui que ce soi, en public ou
en privé : voilà ce que l’on souhaite au contact de la violence comme au
sortir de ce livre.
Ici, le seul réconfort de la
narratrice est la présence aimante de sa sœur qui partage son sort, ainsi que
ce livre qui lui est dédié (« À
ma sœur, Nous deux contre le reste du monde. »)
Et ce, malgré les sept autres enfants de la famille et les tentatives du père
pour les séparer. Au moment des faits et à plusieurs reprises, l’école, le tribunal,
la police (auprès de qui la narratrice, conduite par sa propre mère, doit
témoigner en faveur d’une camarade incestée) auraient pu intervenir s’ils
n’étaient eux-mêmes des dispositifs disciplinaires d’une société d’hommes (« Le juge aussi est un homme ») adultes (L’avocat de la
défense : « Les
enfants mentent »). De
même que la mère, si elle était suffisamment bonne, au lieu d’être
complice.
« Mon premier souvenir
d’enfance (…) Elle lui interdit ce jour-là de nous pénétrer. La mère sait très
bien qu’à part cuisiner et écarter les jambes, elle ne sert pas à grand-chose.
Alors si son mari en venait à baiser les enfants, à quoi, elle,
servirait-elle ? »
« La
mère participe à l’inceste » :
la narratrice le répète. Comme se répète la violence. Une mère « hargneuse », omniprésente par son
silence, son inaction, sa complicité. Une mère qui nie les attouchements sur
ses filles, attachées, clouées devant un film porno trash. Une mère violée
devant elles, violées par procuration, en avant-goût de ce qui les attend. Une
mère « kidnappée » à seize ans par leur
bourreau, dressée en quelque sorte par lui pour banaliser, accepter et faire
accepter cette non-vie d’insultes, faite de coups et de viols à répétition,
malgré la terreur et les cauchemars. Une mère qui verrait son existence reniée,
sa famille détruite, si le pouvoir du père tel qu’elle l’a toujours connu et
supporté était renié, dévoilé ou dévoyé.
Ce pouvoir du père sur son
entourage – femme et enfants minorisées dont il use et abuse en bon
propriétaire, possédant sa femme et fantasmant ses filles en prostituées
offertes à d’autres hommes faute de pouvoir les pénétrer lui-même – n’est autre
que celui conféré par nos sociétés patriarcales qui régissent rapports et
transmission. Une logique qui veut que même la question de la libération des
enfants et des femmes soit posée par ceux qui en abusent sexuellement. De tels monstres
existent, ils sont partout, on ne peut les ignorer : l’espace public
comme privé est à eux, fait par et pour eux : ils assoient leur pouvoir, s’écrivent
et passent à l’acte dans la littérature et dans la réalité par leur
participation active à une culture du viol.

« On dit qu’il est normal d’avoir peur du viol. Que son idée seule terroriserait n’importe quelle femme. Moi, le viol ne me fait plus peur du tout. J’ai reçu suffisamment de coups, de haine et de crachats pour ne plus trembler devant la possibilité d’un contact non désiré. Mon corps a été maltraité tant de fois, mes os battus, que ma chair a été vidée de son sacré. »
« La peur nous
a été inculquée avant même le mot pour la nommer. Je me souviens d’une
sensation diffuse. Un picotement sous la peau. La peur mobilise le sang dans les veines du cœur. Laisse l’extrémité des doigts et des orteils glacée. »
On ne peut ici séparer l’homme de
l’artiste ou du bourreau, sinon à la hache. Quand Sade, noble tortionnaire couvert
par sa famille bien qu’embastillé par elle, compense sa frustration par ses
écrits (dont semble tirée la scène de Chienne où le père est imaginé
offrant les orifices découpés de ses filles) passe pour un chantre de la
liberté victime de l’arbitraire. Quand Sollers, en pape des lettres, répète
avec Casanova qu’il est naturel de désirer sa fille et même de coucher avec elle.
Quand Matzneff, pédophile notoire, après avoir manipulé à coup de rhétorique et
d’esthétique ses amants, amantes, lectrices, lecteurs, est défendu par des élus
que l’on découvre eux-mêmes pédophiles. Quand un président nomme un ministre
accusé de viol à deux reprises et dit, pour sa défense, qu’il lui a parlé « d’homme à homme » (faudrait pas être dérangés).
Si – comme on le constate
systématiquement quand il s’agit de violences spécifiquement exercées contre
les femmes et les enfants – un homme se sent, à la lecture de Chienne,
attaqué ad hominem et obligé. 1/ De se dédouaner (« le père ne reflète #pas
tous les hommes » – « Pas tous les hommes, mais
assez pour qu'on ait toutes peur »
répondent les colleuses). 2/ De se plaindre « qu’on
ne peut plus rien dire ni faire »
(on se demande qui est qu’on). 3/ De minimiser, d’excuser, de donner raison, de
jouir des sévices infligés : l’on comprendra que ce n’est pas le livre le
problème. Ce n’est plus qu’une question de genre : c’est une question
d’empathie, d’éthique, de respect – pas de mauvaise foi, de faux discours, de
faux-semblant. Rien ne peut excuser qu’une personne soit traitée plus vilement
qu'une chienne devrait l'être.
« Les hommes m’aiment, m’ont
toujours aimée, comme on aime une chienne. À quatre pattes. La langue sortie.
Surtout ne pas grogner, surtout ne pas mordre. Ils me l’ont dit. Leurs
phalanges verrouillées autour de mon cou. Une ceinture une fois. Ils me l’ont
dit des centaines de fois t’aimes ça, hein, maudite chienne. »
La vraie force de Chienne,
c’est de renverser le rapport de force et de valeur, de montrer combien, même
mise plus bas que terre, la narratrice est toujours meilleure que son, puis ses
agresseurs. On dit souvent le sexe comme violence, rarement la violence comme
sexe. Chienne dit. Comment nos sociétés, les femmes et surtout les
hommes qui les font, élèvent les filles dans l’idée de la virginité pour mieux
les saloper, avec la peur qui entoure sa perte et la menace du viol. Une peur
intégrée, perpétuée au quotidien, à l’âge adulte, au fil des générations. Comme
s’il s’agissait d’un fait naturel, un passage obligé, quasi rituel, validé par
la réalité. Une peur prolongée par celle des victimes de devenir violentes ou
pédophiles. Comme si l’éducation et la génétique se rejoignaient pour enfermer l’enfant
conçu à ses croisements, le priver de son libre arbitre plutôt que de lui
permettre d’échapper, en conscience, au cycle de la prédation.
Il faut rappeler sans cesse qu’il
n’y a pas de victime prédestinée, de martyr sans bourreau, de viol et d’inceste
sans violeur. Si cela se dit et se fait d’un côté, se tait et se subit de
l’autre, ce n’est pas parce que cela s’ignore, mais bien parce que tout le
monde sait. Famille, voisins, amis, et jusqu’au plus au sommet de l’Etat :
la majorité sait, se tait et suit, élit et lit ce qu’on lui dit par convention,
confort et bienséance, au sein d’un modèle qui n’a de « sécuritaire »
que le nom. Chienne le sait, le dit, se livre et délivre. C’est pourquoi
ce livre parlera à beaucoup, y compris à cette majorité, même si elle ne veut
pas en entendre parler, ne veut pas se sentir concernée. Ce livre est un livre
majeur au sens où il parle de lui-même pour s’adresser avec aplomb à toutes celles
et à tous ceux qui s’y reconnaîtront, qu’ils et elles le veuillent ou non.

« Il y a tout un pan de la violence que je ne me résous pas à écrire. Ça en ferait trop. Trop de violence dans le même livre. On se dira que j’ai exagéré ou menti. Et toutes les personnes qui me diront que j’ai exagéré ou menti seront mon père. Je ressentirai l’urgence, à chaque fois, de leur planter un couteau dans la gorge. »
« À défaut de pouvoir tuer mon père, je me suis amputée de son nom. J’ai tranché d’un seul coup ce morceau de lui qui me talonnait où que j’aille. »
Le mal est déjà fait, mais tout n’est pas consommé : le pire est à venir, du moins c’est ainsi qu’il se présente pendant qu’il s’affaire. Ici, l’issue n’est pas dans la reconnaissance et la compréhension des sévices infligés par le père (il le sait, en jouit) : c’est que le possédé (par lui-même, par une folie furieuse) soit dépossédé de la violence qu’il exerce, perde l’exclusivité de la monstruosité. Même si cela doit passer par le désir contradictoire et transitoire que son pouvoir soit exercé par d’autres et ses menaces de viol réellement mises à exécution. Le seul moyen d’en finir une bonne fois pour toutes, c’est de tuer le père avec la peur qu’il inspire, de l’expulser du corps et de l’esprit, de bannir jusqu’à son nom. Lui, et tous ceux qui suivront — « Ce
serait la seule vengeance possible. Que tous les hommes que je baise meurent. »
C’est l’empowerment,
l’affirmation du pouvoir de la narratrice malgré les séquelles de sa persécution,
qui permet à la vie de reprendre ses droits sur la mort, de les restituer à
celle qui en était privée, et de briser la chaîne qui retenait la Chienne.
Car si le père dresse, c’est aussi contre lui : c’est quand elle ose lui opposer
un « non », lui dire que cela
suffit, qu’elle le montre tel qu’il est et agit en pleine lumière, vampire sans
neurone, miroir sans reflet, qu’il disparaît. Bientôt le déterminisme fait
place à la détermination. Une intolérance épidermique à l’injustice et à la
violence, une sensibilité à fleur de peau et une force phénoménale se
développent. La difficulté, c’est de parvenir à relâcher sa garde sans presser
la détente. Les superhéroïnes sont toujours des survivantes : il y a la
fois du Jessica Jones et du Wolverine dans Chienne.
Être au contact du monstre ne
contamine pas seulement, cela arme et immunise aussi.
« Je voudrais continuer à
taper sur les touches de mon clavier jusqu’à ce que le bout de mes doigts
saigne.
Que personne ne puisse croire
qu’il s’agit de la fin. »
Au moment où je terminais cet
article, au milieu des montagnes, une femme est venue nous voir, à la
panique : elle cherchait une corde, sa chienne était tombée. Deux jeunes
hommes avaient vu la scène, comment la chienne de quatorze ans qui jouait sur
la falaise avait roulé. Quand nous les avons rejoints, l’un d’eux était déjà à
mi-chemin, la chienne morte à bout de bras, à bout de force. Je l’ai sanglée, hissée
sur mon épaule, soutenue de la main. Nous avons fait le reste de l’ascension en
nous hissant les uns les autres, sans masque ni distanciation sociale,
solidaires et respectueux. Il fallait prévenir les enfants. La mère était au
bord des larmes. Le père, désarmé, un peu rigolard, a pris son téléphone et dit
la vérité crûment.
En y repensant, j'ai revu la
chienne de ma grand-mère jetée sans ménagement dans la benne de l’équarrisseur.
Nous étions elle et moi en visite chez mon père et ma belle-mère. J’étais
encore adolescent, mais cela devait faire dix ans que je refusais de les voir. D’après eux, la chienne avait fui, avait dû s’empoisonner ailleurs pour
revenir mourir sur le pas de leur porte. Que cela nous paraisse étrange n’y
changeait rien, peu importe ce qui s’était passé : on ne sait jamais ce
qui passe par le corps ou la tête d’une chienne. Désormais elle était morte, c’était
fini. Après tout, ce n’était qu’une chienne, on n’allait pas en parler pendant
cent sept ans. D’ailleurs eux aussi avaient eu une chienne, longtemps enfermée
dans le noir, avant qu’elle ne fuie. J'ignorais alors que je m'apprêtais à me jeter de nouveau dans la gueule du loup, qu'il me faudrait encore vingt ans pour m'en tirer vraiment.
À ce moment je me suis estimé
heureux de m’en être sorti.

« J’ai inventé un souvenir d’enfance. De toutes pièces. À croire que j’avais besoin que personne ne sache tout à fait la nature exacte de ma souffrance. Qu’il y ait cette pièce amovible dans le casse-tête. Il y a une justesse biographique plus grande dans ce morceau de mensonge, de fiction, que dans les reconstitutions. Et si un jour j’étais lue. Si j’étais lue, je porterais ce faux souvenir avec encore plus de conviction que les autres. Je dirais même que c’est le seul qui soit véridique, qui nous soit bel et bien arrivé. »
« Moi je sais où les monstres
dorment la nuit. Je sais exactement où. »
Les choses sont parfois plus
complexes et leurs résolutions plus simples qu’elles n’y paraissent : souvent
la réalité épouse la fiction, l’enfante pour le meilleur et pour le pire,
jusqu’à être dépassée, puis remplacée par elle. Chienne est un roman, une
autofiction qui s’écrit, entre déni et mimésis, sans catharsis aucune. Peu
importe que l’autrice ait vécu dans le détail telle ou telle torture : toutes
sont réellement commises, dans le livre comme dans la réalité. Chienne dit
la réalité telle qu’elle se présente, la mémoire telle qu’elle se manifeste, en
particulier lors d’un syndrome de stress post-traumatique : violente, fragmentée.
Il ne dit pas tout le réel : simplement la violence et la terreur qui
l’habitent, mais autre chose existe.
Les blancs sont là pour le
rappeler, qui permettent de soutenir l’insoutenable, mais aussi le récit, comme
autant de fils de chaîne qui sous-tendent, cousent, relient la trame. À l’image
du personnage de la couverture – portrait brisé d’un poupon fait poupée, mais
qui conserve son unité malgré les bris – l’autrice et la narratrice survivent
sans se recouvrir pour autant : nous sommes dans l’auto, pas dans
la non-fiction : ici pas question ici de témoignage, de procès, de
thérapie, mais de littérature. Une littérature de l’intime, qui intime aussi,
ordonne le réel. C'est un livre qui s'inscrit durablement - avant, pendant,
après - son écriture dans la réalité qui prend corps avec lui. Un tour de force
et de courage exemplaire, édifiant et inspirant.
« Je dissimulais mes désirs
dans des textes de fiction, enfant. Deux sœurs en fugue. Pourchassées par un
monstre à deux têtes. Elles s’enfuyaient dans de sombres forêts. S’armaient de
branches, de bâtons. Aujourd’hui, je ne cache plus mes désirs. Je voudrais que
ce texte décime ma famille entière. »
Doctorante en création littéraire
à l'Uqam, Marie-Pier Lafontaine, dont les recherches portent sur « les différentes
représentations de la violence contre les femmes »
signe avec Chienne un livre qui dérange, bouscule, sans chercher à s’en excuser.
Qui dit, brute, la parole d’un dérangé, d’une brute, pour combattre la violence
par la violence. On n’est pas là pour comprendre les motifs du père, les
excuses de la mère, mais pour y répondre coup pour coup, et au-delà. C’est un roman
qui se construit dans la lutte. Attaque, pare et bloque, roule, glisse et
contre, travaille son jeu de pieds contre les vilains jeux de main. Frappe là
où ça fait mal. Ne soigne pas, sinon son style. Pense avant, panse après. Avec Chienne,
la littérature aussi est un sport de combat.
Chienne est un livre qui
n'épargne rien ni personne. On le referme avec une colère, une rage, une
volonté de ne plus se laisser faire, littéralement : de ne plus se laisser
abuser, construire et enfermer par l'abus. Nous avons, la plupart du temps et
avec raison, peur de la violence : celle des autres, mais aussi la nôtre.
Il faut se réconcilier avec la seconde afin de vaincre la première. Le livre
est violent car la réalité est violente. Pour être entendue et crue, il faut
parfois se montrer crue. La vraie question est de savoir quelle société nous
voulons. Dans l’état actuel des choses et des hommes, il s’agit de ne plus laisser
aux hommes le monopole de cette violence. De s’emparer des armes (, )du pouvoir,
et de discuter après. De trouver la liberté de dire et d'être.

« À quoi bon écrire chaque épisode, chaque violence, chaque soumission. Jamais personne ne pourra comprendre ce que c’était que de grandir sous le même toit que cet animal. Et même si j’avais des photos à montrer et des enregistrements vidéo et d’autres photos encore, il faut l’avoir vécu dans son corps pour comprendre. Je fais partie des éclopées. De ces gens qui ont expérimenté au plus près du cœur la déchirure du monde. Je ne crois en rien si ce n’est en la capacité des hommes à détruire.»
« J’aurais voulu écrire un
roman sur mon enfance, avec des pages et des pages remplies d’écriture. Sans
espaces blancs, sans pauses ni silences. Que l’on comprenne bien tout le
vacarme que fait faire la peur de mourir à un cœur. »
Comment communiquer aux autres cet
inexprimable auquel on a survécu sans risquer de les abattre ? Comment ne pas ressentir
soi-même parfois - selon les jours, les événements – cet abattement face à
l’indifférence, à la violence des mots et des gestes, à la poursuite d’un ordre
politique, économique et social invivable ?
Comment vivre, lutter et endurer tout ça, sans se dire à un moment à quoi bon,
et sans le dire aussi ?
C’est parce que cette désespérance qui accompagne la vie est forcément
importante, à dire et à écrire, que le comment l’emporte sur le pourquoi, parce
que la survie physique et mentale en dépend, parce que c’est ça ou la mort.
C’est d’ailleurs un des pivots du
livre : s'autoriser à écrire, à dire, à être lu, à lire. Ici aucun
compromis. Il s’agit de faire exister, de ne plus nier l’évidence et les
preuves accablantes des souffrances et violences systémiques, constantes,
omniprésentes, faites aux femmes et aux enfants. La question c’est :
qu’est-ce que l’on fait de ça ?
Sur le plan humain et littéraire. Autrement dit : que faire de cette
expérience dans l’écrit, puis de cette expérience de lecture ? C’est pourquoi Chienne
est, plus que jamais un livre nécessaire. Parce qu’on ne peut, qui que l’on
soit, ajourner la possibilité de savoir, de dire et d’agir, sans être complice.
S’il faut expliquer la vie que ce
soit à armes égales. Nous avons besoin d’une littérature sororale,
bienveillante, amie. Qui déconstruit, brise ces patterns patriarcaux qui, sous
le couvert du constat post-moderne, étalent encore les fantasmes et
l’impuissance de ceux qui les écrivent comme ils jouissent : seuls et avec
mépris. Chienne rapporte comme on lui a appris, mais à sa façon. Chienne
dit les choses comme pas un, s’inscrit dans un corpus de littérature autofictive,
intime, féministe et politique, de la révolte et du combat qui, loin d’être
isolée, marginale, exhibitionniste, s’élève dignement, en termes d’éthique
comme d’esthétique, aujourd’hui.
« Je n’arrive pas à écrire
avec suffisamment de haine. Que m’arrivera-t-il si ce texte ne suffit pas à le
tuer ? »
On sort de cette histoire moins
(r)assuré.e, mais dans le même temps plus déter que miné.e. À bien y penser, ce
n’est pas (plus) un livre que l’on a entre les mains, mais une arme. Une arme assemblée patiemment, pièce
par pièce, geste après geste, avec détermination, avec le blanc des pages comme
plan de travail, tout au long de ce que l’on a cru être un roman. Une arme parfaitement
lestée, efficace, à la mécanique précise, où chaque rouage s’enclenche se joue
au millimètre près. Où les vides même constituent l’âme du canon, qui
permettent de loger une balle entre les yeux ou les jambes (maculer/émasculer,
c’est tout un) de l’ennemi.
Une arme moins par nature que
par destination. Une arme dont le sens de la visée varie selon que nous nous
tenons d’un côté ou de l’autre de la ligne de mire. Une arme qui confronte et
tient à distance, menace et protège, défend aux oppresseurs, défend les opprim·é·e·s,
livre et délivre. Une arme qu’il suffit de saisir pour ressentir et dire : Nous avons ouvert les portes et quitté
les foyers. Nous avons pris le maquis, les sentiers. Ne nous rejoignez pas
avant d’avoir vraiment franchi le pas. Nous avons besoin de chemins. Nous avons
besoin d’une littérature qui ne soit pas qu’un mémorial des victimes, mais qui
nous nourrit, nous abrite, nous réunit, nous arme.
Ce livre est une arme. Pas une heure ne passe sans qu'une femme, un enfant, tombe sous les coups. Pas un jour ne passe sans que
parlent les armes. Il serait temps de trouver le
courage de les écouter, d'apprendre leur langage.
Crédits : (CC) Eric Darsan pour le texte et la photo de couverture ; © Le Nouvel Attila & Marie-Pier Lafontaine pour tout ça, et le graphisme de la couverture, les extraits, la présente édition ; © collages feminicides Rennes, © achlys chimon,© collages feministes Marseille, © collages feminicides Lyon, © collages feminicides Paris pour les photos de collages que vous pouvez retrouver sur instagram et partout dans les rues, avec l'immense travail et le courage que cela exige.