Après sa Naissance de la gueule et sa participation à Chambre froide, Al Dante poursuit la publication des recueils d’A.C Hello au sein des Presses du réel, avec la sortie de son Koma Kapital le 12 mars 2021. Un volume vivant qui fait corps et crie contre l’ennemi commun et la banalité du mal — politique économique salarial social patriarcal, c’est tout un. Une boîte à outils chargée de pinces et tenailles, de clous et de vis, d’où dépassent un pied de biche et quelques morceaux de corps entassés au gré de carnages soignés. Un pavé bien serré, bien qu’illustré à chaque chapitre, et même un peu plus — corps dans le corps du texte, résultat d'un très beau travail éditorial. Un petit livre noir mat en 12x17 qui met en échec le formatage 10/18, les mises en forme et garde et les pages du même nom, attaque et titre en capitales sur une gravure de femme parasitée par des mouche(ron)s qui nous guident jusqu’à la table.
Six textes, six salves, six-coups : juste ce qu’il faut ressentir la déflagration, la pression de la peau sur les os, la secousse des heurts, leurs sursauts, à-coups. Plonger sous la surface, faire sauter l’artifice, creuser la roche métamorphique, pour approcher la nature puissante et mouvante de ce Koma Kapital dont on ne se remet pas.
« le vent me violait sous le ciel bleu, je dégueulais de la viande, ça s’était sûrement produit dans cette rue pleine de boue où l’on m’avait jetée, cette rue que flanquaient des gros garçons livides dont je ne me souviens plus le nom, des gros garçons qui rêvaient de victoire et d’écrasement »
Dissolution mémoire identité structure. Une
catastrophe s’est produite, qui a dissous le temps et l’espace, les corps morts
ou vifs qui flottent à leur surface. Quelque chose fait que l’on se retrouve
dans un mouroir, qui évoque Le Miroir des Limbes : Lazare. Râles,
maux, et ces mouches qui transmettent la maladie du sommeil. Maux = mots, ou
l’inverse. Quelque chose encore d’Artaud à l’asile, le corps pris à la lettre.
Koma à la Kahlo, calée dans un corset, et le poids des mots comme un, comme une
boule ronde ou un os — en travers. Si peu de points auxquels se raccrocher,
poser une question, répondre par l’ignorance, l’impuissance, la fuite. Sentir
seulement, mais tellement. Se dire jusqu’à se taire, se terrer, se laisser
écraser par le poids de l’indicible.
Découvrir malgré soi l’origine. De la mort en même temps que celle de la (re)naissance, non de la gueule, mais de la tête. Des yeux de la voix et de leur grande histoire. Celle d’une stupeur ou d’une terreur telle. Qu’elle paralyse les sens et (« je ne sais pas où j’étais, je n’ai jamais bien su, je n’ai jamais été là, ça ne m’intéressait pas. ») passe pour un consentement. Quand c’est tout le contraire qui se ressent, avec la terrible souffrance que cela induit, colère que tout cela engendre. Qui se décuple avec les millions de foutus, et l’infinie poésie qui en résulte, exulte, sonore et obsessive, quand la phénoménologie rejoint la folie pour tenter d’atteindre un tant soit peu, mais déjà tant, l’expression de ce trop-plein d’être au monde — ce que c’est/ce serait d’ex-ister vraiment.
« Un jour j’avais posé mon visage à côté de moi, afin que tout ce qui était au-dedans soit projeté à la surface et que chaque chose étouffée par la totalisation se disperse. »
La persistance du choc, qui se manifeste déjà, sans stratégie apparente : juste reflux des choses et autres, qui errent sans but, surgeons repoussés dans la marge. C’est alors qu’ON arrive, se présente – dont on ne retient pas le nom. (« Il fallait que je me rendre à l’évidence : ce connard troublait ma lente torsion des choses. ») Un monsieur-je-sais-tout(-ou-rien), de ceux qui prétendent sans entendre (« — Mais ta gueule putain, ta gueule. »), suivi de tous ses acolytes experts en aqua et mansplaning (« un homme rempli d’eau avec un insecte dans la tête »). Les choses, suivant leur cours, ne tardent pas à perdre pied et racines pour faire feu de tout bois et jazzer sur les cordes de la contrebasse. Là encore, point de repère : suivre les analogies, nager sur les pas perdus de Nadja. Psychogéographie de contes défaits, ivresse de la dérive, où s’use comme d’une bouée, d’un amer, le nom de chacun de ces types qui sont toujours et jamais le même, vulgaire et vain.
« QU’EST-CE QUE TU VOULEZ QUE JE FASSE DE TOI ? T’AVEZ BESOIN DE REPASSER UN DIPLÔME ? TU N’AVEZ PAS ASSEZ FAIT D’ÉTUDES ? »
Obstruction. Ode aux Grand Travaux Inutiles, devenus Projets Inutiles et Imposés, sans objet ni but. Qui voient l’affrontement entre le Oui et le Non (ou plutôt une mise à mort de l’autre par l’un), où tous les moyens sont bons pour. Anéantir le Non : le Oui s’entend à cela, qui use de tous les pouvoirs de police et de justice (dont il dispose, car) mis à sa disposition et l’exp(l)ose dans le détail. Malgré ce quelque chose de désespérément beau qui rappelle Sablonchka (« De ses doigts, il ouvre le ciel et utilise le fond des étoiles, humide et noir, pour repousser les limites de son territoire incendié ») avant un retour aux (ir)réalités de la ménagerie managériale. Où l’on voit la narratrice, spamée par des actualités idiotes, faire faux-bond au dénommé Rudi qui la rudoie, clown robotique sinistre et cynique, criant de (contre)vérité dans cet univers kafkaïen.
CEO de l’entreprise Galaxy First, ledit Rudi, éructe et vocifère pour se faire la voi-x/-e sans issue (TINA) du grand Kapital. Conjugue le singulier au pluriel et crie en capitales, d’une façon si absurde et si réaliste (« TU VENEZ ME VOIR OU TU ALLEZ VOIR LA DRH. ») que le tragique devient hilarant, pour vanter les bienfaits de la destruction et de l’esclavage mondialisé et prôner la surveillance, l’exploitation et la manipulation, la délation et le harcèlement des employé·e·s à qui il mène la vie rude, parmi lesquel·le·s la narratrice qui lui fait obstruction — odieux, aux acolytes acronymes comme au CEO, le Kapital est une patrie peu reconnaissante (« DE TOUTE FAÇON, LE CAPITALISME TROUVERA UN MOYEN DE SUPPRIMER LES SALARIES…TIENS, TOI PAR EXEMPLE ! UN JOUR, TU SEREZ PEUT-ÊTRE UN HOLOGRAMME ! »).
« Je rentre chez moi, convaincue que je ne m’en tirerai jamais. À cause d’un travail qui ne me permet pas de vivre. »
Extinction. Le programme continue : des films qui existent ou pas, toujours ponctués de flash-infos. Le sommeil gagne sans que l’on puisse s’y perdre ni s’y retrouver. (« L’angoisse du lendemain m’envahit toute entière. ») Entre Chômage Monstre, Bartleby et Fight Club, Quoi faire, entre le cauchemar et sa réalité. L’enfer du devoir, du travail — ni fait ni à faire. La mécanique mortifère, la sidération que sa cruauté produit (« Son œil froid me découpe au couteau. »), quelque chose du Chonométreur (« Je travaille, paralysée, jusqu’à vingt-trois heures. Ma peau est collée à mon bureau. ») qui nous pousse Jusqu’à la bête (« Contaminée par les images lumineuses. Le monde est absent. Je me synchronise à l’anéantissement collectif. »). Se retourner et s’écraser sous le poids des murs, des draps, des sollicitations, des injonctions à la reproductivité en attendant de succomber une bonne fois pour toues à l'assaut des moucherons — perdre sa vie à la gagner.
« — TU T’EN SORTES ? »
Immobilités. Où se suit, sans se ressembler, l’une après l’autre, une
Poésie radicale sans avenir
sans imagination,
fracturée,
possédée,
fantôme
qui est le contraire contrit de ce qu’elle dit,
mais qu’il faudra aller chercher dans le corps du texte car, après et malgré
tout, ce corps existe.
« Corps existe. Puis efface tout. Puis existe. Puis efface tout. Ainsi de suite, jusqu’au déclin du jour. »
Pilote fantôme [épilogue]. Conduite auto-/fantô-matique d’un être là, réduit à ses fonctions (Be a Body/I lean on walls until I stand), en perte d’essence et de vitesse. Où le renoncement rejoint la réification. Alors quoi, sinon sortir du cercle, des sales draps dans lesquels tout s’emmêle, sue sang et eau, la détraque et la détresse, le vide et les insomnies, l’engourdissement et l’angoisse. Se mettre en mouvement, rejoindre Les Échappées, se faire L'Arrachée belle. Fuir pour ne plus revenir de tout, repartir à l’instant zéro pour s’expandre à nouveau — « Nous tous, séparés les uns des autres, comme un ensemble dans ta tête particulière, avons grand besoin de lumière. » Nous tous, comme une litanie, une prière, la toux d’un tout qui s’exclut de lui-même — « Nous tous. Acharnement. Vague espoir. Exil. Nausée. » Nous tous, pas des millions, mais des milliards d'humains. — « nous tous allons retourner ta langue et jaillir par ton front. »
Koma Kapital se lit comme le voyage initiatique de personnages singuliers. Dans le ventre de lieux communs d’une étrange familiarité. Au creux d’un programme écrit pour et malgré elles et eux. Recueil et roman poétique beau et puissant composé de textes en chute libre à la manière de nouvelles. Un fil rouge tendu entre elles comme un filet de sang ou de salive — sol, hôpital, boule, marche, surlignages, mouches, mortes, CEO. Et avec ça « l’impuissance à dire », qui se dit pourtant, partout, et cependant jamais assez au regard de l’ampleur de l’horreur bien réelle, poussée dans ses retranchements dans un(e)geste hyperbolique et dadaïste, car entrevue avec acuité à travers « les tressaillements de son intelligence aiguë ». Intelligence du corps, de la conscience et de la perception, de la langue et du son.
Une intelligence qui parcourt tout le livre, sue, mais tue, gardée en soi et pour soi par les personnages, pour survivre à travers ce champs de mines défaites qui compose l’humanité occidentale post-moderne. Le regard affûté, la tête et la bouche et les mains pleines d’images d’une dinguerie surréaliste, de glissements virtuoses (« Dans le ciel, un viol de mésanges »), de dialogues ultrash (« — Putain, cuve à foutre, t'as l'air aussi paumée qu'une fille de pute, le jour de la fête des pères ! »), pour décrire décrier et crier la douleur du rapport dans cette relation systématiquement asymétriques. Au monde, à soi et aux autres, au corps et à la sensation, à la totalisation et à l’anéantissement. Aux névroses, psychoses, zoonoses, et autres oses alcoolisées pour dévoiler l’homme de l’ombre de l’homme (qui a vu l’homme) derrière le rideau.
Anormale et atonale, la poésie d’A.C. Hello est une arme de déconstruction massive à répétition. Une fiction panier pleine, chtonique et (anté)diluvienne qui, près avoir creusé la terre en tunnel, passe au-dessus de la tête pour venir cueillir des pommes d’Adam, les mettre à jour et à vif, opérer à cœur ouvert et hurler à pleine gorge contre la brutale et tendue banalité du mâle qui retombe, molle, après chaque semblant d’érection. Les sis six textes s'y entendent pour former un enfer déferlant sur cent douze pages d’une poésie dense, danse poétique débordant d’écume et d’écueils contre la gangue de la cadence. Chaque mot est une phrase et chaque phrase un monde que j’ai ici ouvert à d’autres en faisant jouer l’intertextualité quand ils se prêtent bien davantage à une exploration hyperceptive.
« il ne s’agit que de, il ne s’est toujours agi que d’une, cette seconde, il ne s’agit que de cette seconde, il ne s’est toujours agi que de cette seconde »
Koma Kapital c’est un choc en retour organique et viscéral, un doigt et un baroud d’honneur, un backlash façon kalash qui krépite face à la face flasque du kkkapital. À la manière des Éléments de sabotage passif du regretté Cédric Demangeot, fondateur des éditions Fissile chez qui A.C. Hello est apparue avec son Paradis remis à neuf, Koma Kapital fait du poison un remède et du remède un poison, combat le feu par un feu plus grand, et appelle à la désertion du travail de désertification en même temps qu’à son apparition. Dans ce festin nu, c’est le métier de vivre, le travail de la viande, qui importe. Avec le temps, la charge s’accroît : tout s’y tient, se contient ou se déploie, rien ne s’émonde. Au sein du Kapital, État global où la peine est perpétuelle et le chagrin maximal, le Koma n’est pas une posture, une figure de style, mais le geste salutaire d’une magie opératoire.
Bonus Track (Kaos A.D.) : A.C. Hello, qui
refuse/résiste au livre la primauté et l'exclusivité des situations qu'elle
construit et déconstruit, a déjà joué/enregistré/publié/performé/déformé
un certain nombre de ces textes, que ce soit en revues (dont Frappa,
qu'elle a créée), fanzines, disques (notamment avec MelmAC.Hello), vidéos,
improvisations, et autres lives dont on peut retrouver la liste à la fin
de l'ouvrage et des morceaux un peu partout sur et en dehors de la toile. Une
démarche, des supports et matériaux, qui se prêtent et ouvrent, de la même
manière, à d'infinies et inépuisables découvertes et relectures. Et une œuvre
qui se poursuit et se croise de telle façon que l'on ne peut augurer du temps
et de l'espace au gré duquel ce travail d'alchimie se fera, ni des effets
qu'elle aura intro- ou rétro-spectivement sur soi, si ce n'est qu'elle se fait
pour moi assez clairement avec la sortie de ce Koma Kapital.



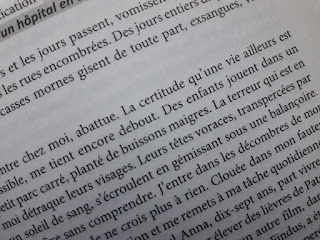


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire