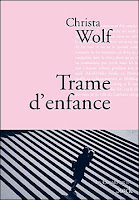Après avoir abordé Fictions et Fantaisies par le biais de Bric-à-brac man de Russell H.Greenan, puis du Journal d'Adam, Journal d'Eve de Mark Twain, c'est au tour de la collection Mémoires et miroirs de faire son apparition dans cette nouvelle édition d'Un éditeur se livre organisée par Libfly et consacrée à L'oeil d'or.
Issu des travaux de recherche d'Emmanuel jouet, La révolte des enfants des Vermiraux est une monographie très documentée destinée à saisir les « Approches d'une économie des secrets dans une institution éducative » du siècle dernier qui se place d'emblée sous les augures de ce triple impératif du devoir, du vouloir, et du pouvoir.
Fondé en1882 l 'Institut sanitaire
des Vermiraux « pour le redressement intellectuel des
anormaux » devient en 1905 - date de séparation de l'Eglise
et de l'Etat - une institution morale et privée. Dans cette optique la
plaquette du projet insiste ainsi sur la nécessité d'un contrôle extérieur et
indépendant, détaille le soin apporté à l'environnement, au cadre de vie,
alliant espaces naturels, confort moderne et équipements culturels, des jardins
à la literie en passant par la nourriture, le vêtement, le travail et sa
récompense. Or, malgré tous les bons sentiments exprimés, c'est bel et
bien le caractère « utile » et « économique »
qui revient sans cesse et dont se félicitent les différents
souscripteurs au projet.
Ici, nul « complot » ainsi que le rappelle l'éditeur, Jean-Luc André d'Asciano, nul « pervers », non plus que nul pathos, mais un ethos, c'est à dire une habitude qui va se muer en manière d'être et identifier bourreaux et victimes jusqu'à les définir avant même de les faire apparaître comme tels. Une attitude mue par l'«avarice» et l'« âpreté au gain » des directeurs et de leurs acolytes, à commencer par l'omniprésent et omnipotent Landrin qui, se prévalant de tous les titres, grâce aux appuis, chantages et manipulations auxquels il a recours va parvenir non seulement à obtenir la main sur la vie toute entière de l'établissement et de ses occupants mais encore à échapper à toute poursuite dans un premier temps.
C'est cependant l'illégitimité de sa position et l'évidence des maltraitance qui va progressivement mener à leur inculpation en lieu et place de celle des enfants révoltés. Toujours plus nombreux, constituant une main-d'oeuvre gratuite et corvéable à souhait, privés de soins et de nourriture, entraînés dans une « spirale de surviolence » jusqu'à la mort « par abandon ou maltraitance », ces pensionnaires - « muets, rampants, sales, décharnés, à moitiés vêtus », décrits comme et n'ayant « plus rien d'humain » - livrés au commerce et aux abus sexuels, réduits à l'évasion, à la révolte ou au suicide pour tenter d'échapper à leur sort et d'avertir les autorités et l'opinion, vont finalement attirer l'attention du procureur et de la presse.
« D'une utopie à sa dérive », Emmanuelle Jouet, docteur en sciences de l'éducation et chercheuse en psychiatrie sociale, égrène ainsi une à une les déclarations (plus ou moins vraies) et intentions (bonnes ou mauvaises) qui ont présidé à l'avènement du drame. Manoeuvres des uns, révoltes des autres, procès et, enfin, dévoilement de cette fameuse « économie du secret » : tels sont les grands axes de cette étude qui met en lumière la part d'ombre non seulement de quelques obscurs protagonistes mais un processus progressif, honteux et discret mais néanmoins systémique, de déshumanisation de ces enfants « arriérés », « vicieux », « dégénérés », « idiots », « inadaptés », qui cependant apparaissent plus conscients que leurs gardiens. Encore l' «affaire des Vermiraux » n'est-elle exceptionnelle que par l'ampleur de cette « surviolence », le retentissement qu'elle a provoqué et l'attention dont, par suite, ont fait l'objet des institutions moins bondés et donc moins susceptibles de se rebeller.
En vérité, derrière la philanthropie affichée, au nom du « vivre ensemble » et d'une sociabilité qui se veut respectable et structurée au regard de la dangereuse et incontrôlable délinquance qu'elle est censée endiguer, violences, exploitations et escroqueries apparaissent bel et bien comme le lot commun de ces établissements. Des instituts dont la visée « prophylactique » - déceler et prévenir – pose elle-même problème en liant, sous l'angle du corps et de l'esprit, la médecine et la morale, par le biais de ces hygiénistes et autres « aliénistes », préconisant « d'étudier avec soin les coordonnées anthropométriques des jeunes sujets dont on aura à suivre le développement et sur lesquels on pourra étudier les effets du traitement ». Des méthodes qui rappellent combien la prison constitue non pas la marge mais à la fois le laboratoire et l'idéal de gestion de nos sociétés modernes ainsi que l’a brillamment démontré Michel Foucault dans Surveiller et punir.
Ayant pour source principale le journal d'un notable local mis en ligne par sa petite-fille, les travaux de celle-ci, ainsi que le réquisitoire et un travail de terrain facilité par quelques rares habitants déterminés à voir ressurgir l'affaire,La Révolte des enfants des Vermiraux, bien qu'illustré avec sobriété par Sarah d'Haeyer, demeure bien
sûr un ouvrage très universitaire limité à une époque restreinte et à un sujet précis.
Néanmoins, si l'on peut regretter que l'essentiel soit constitué
de témoignages d'archives aussi sinistres que redondants - afin de faire apparaître
l'écart entre « le projet initial des Vermiraux rêvés et la
finalité des Vermiraux jugés » et éviter le risque d'« illusion
rétrospective » qui tendrait à juger le passé en fonction du présent,
ferait oublier que l'enfant n'était pas une personne, ou encore que la violence
évoquée n'était pas normale pour autant - il permet dans le même temps d'interroger
la façon dont la logique utilitariste, malgré les exactions qu’elle autorise, et
sans doute grâce à elles, peut et a pu s’imposer par le passé jusqu’à s’étendre
aujourd’hui à tous les domaines de la vie.
Fondé en
Ici, nul « complot » ainsi que le rappelle l'éditeur, Jean-Luc André d'Asciano, nul « pervers », non plus que nul pathos, mais un ethos, c'est à dire une habitude qui va se muer en manière d'être et identifier bourreaux et victimes jusqu'à les définir avant même de les faire apparaître comme tels. Une attitude mue par l'«avarice» et l'« âpreté au gain » des directeurs et de leurs acolytes, à commencer par l'omniprésent et omnipotent Landrin qui, se prévalant de tous les titres, grâce aux appuis, chantages et manipulations auxquels il a recours va parvenir non seulement à obtenir la main sur la vie toute entière de l'établissement et de ses occupants mais encore à échapper à toute poursuite dans un premier temps.
C'est cependant l'illégitimité de sa position et l'évidence des maltraitance qui va progressivement mener à leur inculpation en lieu et place de celle des enfants révoltés. Toujours plus nombreux, constituant une main-d'oeuvre gratuite et corvéable à souhait, privés de soins et de nourriture, entraînés dans une « spirale de surviolence » jusqu'à la mort « par abandon ou maltraitance », ces pensionnaires - « muets, rampants, sales, décharnés, à moitiés vêtus », décrits comme et n'ayant « plus rien d'humain » - livrés au commerce et aux abus sexuels, réduits à l'évasion, à la révolte ou au suicide pour tenter d'échapper à leur sort et d'avertir les autorités et l'opinion, vont finalement attirer l'attention du procureur et de la presse.
« D'une utopie à sa dérive », Emmanuelle Jouet, docteur en sciences de l'éducation et chercheuse en psychiatrie sociale, égrène ainsi une à une les déclarations (plus ou moins vraies) et intentions (bonnes ou mauvaises) qui ont présidé à l'avènement du drame. Manoeuvres des uns, révoltes des autres, procès et, enfin, dévoilement de cette fameuse « économie du secret » : tels sont les grands axes de cette étude qui met en lumière la part d'ombre non seulement de quelques obscurs protagonistes mais un processus progressif, honteux et discret mais néanmoins systémique, de déshumanisation de ces enfants « arriérés », « vicieux », « dégénérés », « idiots », « inadaptés », qui cependant apparaissent plus conscients que leurs gardiens. Encore l' «affaire des Vermiraux » n'est-elle exceptionnelle que par l'ampleur de cette « surviolence », le retentissement qu'elle a provoqué et l'attention dont, par suite, ont fait l'objet des institutions moins bondés et donc moins susceptibles de se rebeller.
En vérité, derrière la philanthropie affichée, au nom du « vivre ensemble » et d'une sociabilité qui se veut respectable et structurée au regard de la dangereuse et incontrôlable délinquance qu'elle est censée endiguer, violences, exploitations et escroqueries apparaissent bel et bien comme le lot commun de ces établissements. Des instituts dont la visée « prophylactique » - déceler et prévenir – pose elle-même problème en liant, sous l'angle du corps et de l'esprit, la médecine et la morale, par le biais de ces hygiénistes et autres « aliénistes », préconisant « d'étudier avec soin les coordonnées anthropométriques des jeunes sujets dont on aura à suivre le développement et sur lesquels on pourra étudier les effets du traitement ». Des méthodes qui rappellent combien la prison constitue non pas la marge mais à la fois le laboratoire et l'idéal de gestion de nos sociétés modernes ainsi que l’a brillamment démontré Michel Foucault dans Surveiller et punir.
Ayant pour source principale le journal d'un notable local mis en ligne par sa petite-fille, les travaux de celle-ci, ainsi que le réquisitoire et un travail de terrain facilité par quelques rares habitants déterminés à voir ressurgir l'affaire,